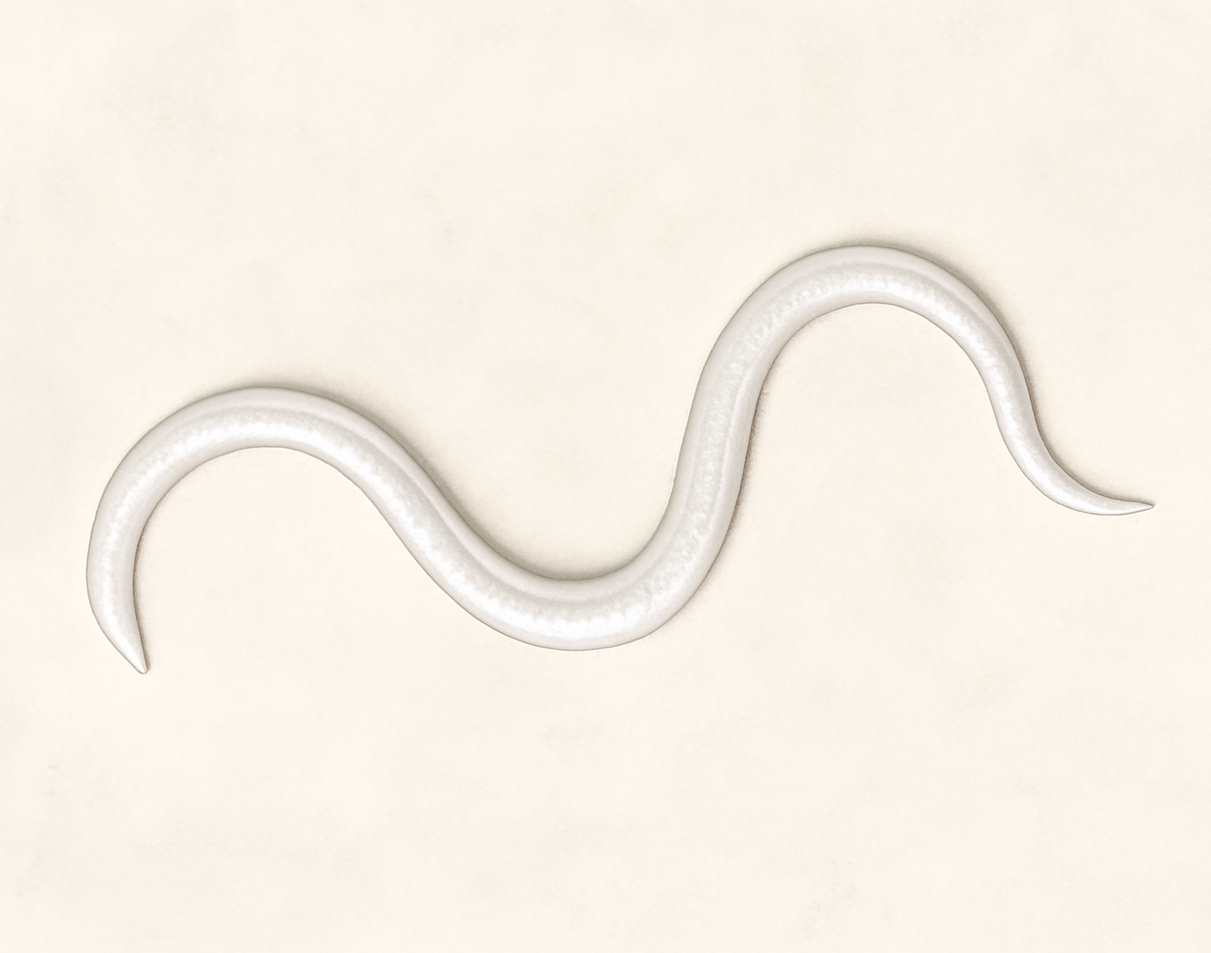Andry Rajoelina a présidé Madagascar de 2009 à 2014, puis à nouveau de 2019 jusqu’à son renversement ce jour par l’Assemblée nationale, soutenu par la rue et l’armée. Son second règne se caractérise par des réalisations majeures en infrastructures de santé, mais aussi par des fragilités structurelles qui ont pesé sur l’accès et la qualité des soins.
Développement des infrastructures hospitalières
Au cours de ses deux mandats, Andry Rajoelina a fait construire au minimum 36 hôpitaux généraux et centres hospitaliers universitaires (CHU). L’an dernier à Ivato, il a inauguré un dépôt de vaccins doté de 400 m³ de chambre froide, présentée comme la plus grande d’Afrique.
Pourtant, ces avancées n’ont pas suffi à compenser le déficit chronique d’équipements : on ne recense que 0,14 lit d’hôpital et 0,20 médecin pour 1 000 habitants. Par ailleurs, plus de 35% de la population vit à plus de 10 km d’un centre de santé, et 75% des centres de santé de base peinent à conserver les vaccins en raison d’une électricité instable. Ces délestages répétitifs ont d’ailleurs été l’un des motifs des manifestations qui ont conduit à la chute de son régime.
Gratuité des soins d’urgences et limites pratiques

En 2021, les soins d’urgences sont officiellement devenus gratuits grâce au Fonds d’urgence sanitaire national. En pratique, l’absence fréquente de renouvellement des médicaments et consommables rend parfois cette mesure inopérante, comme si elle n’existait pas pour de nombreux patients.
Bilan chiffré des mandats d’Alassane Ouattara en matière de santé
Les maladies infectieuses (pneumonie, diarrhée, paludisme) sont restées responsables de 50% des décès, tandis que les maladies non transmissibles, notamment les pathologies cardiovasculaires, représentaient 40% des décès. Le secteur de la santé demeure majoritairement financé par des sources extérieures, à hauteur de 55–60% du budget, comme dans plusieurs autres pays africains.
Covid-Organics : promesse et controverse
Beaucoup d’Africains ont soutenu que cette fragilité budgétaire était l’une des raisons du mépris international à l’égard du Covid-Organics, qu’Andry Rajoelina avait lancé en pleine épidémie de Covid-19. Imprudemment, il avait vanté ce « médicament miracle » sans essai clinique, issu de la médecine traditionnelle locale. Une étude in vitro a montré une inhibition du SARS-CoV-2 par le CVO à certaines concentrations, sans toutefois garantir que ces niveaux soient atteignables in vivo. L’on se souvient des débats passionnés des souverainistes africains à ce sujet.
Cet état des lieux souligne l’ambition des projets infrastructurels lancés sous Andry Rajoelina, tout en révélant les défis persistants liés à l’équipement, à la pérennité des services et à la rigueur scientifique dans la gestion des crises sanitaires.
Dr Euclide OKOLOU